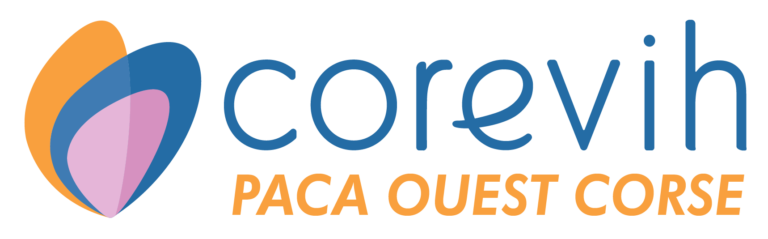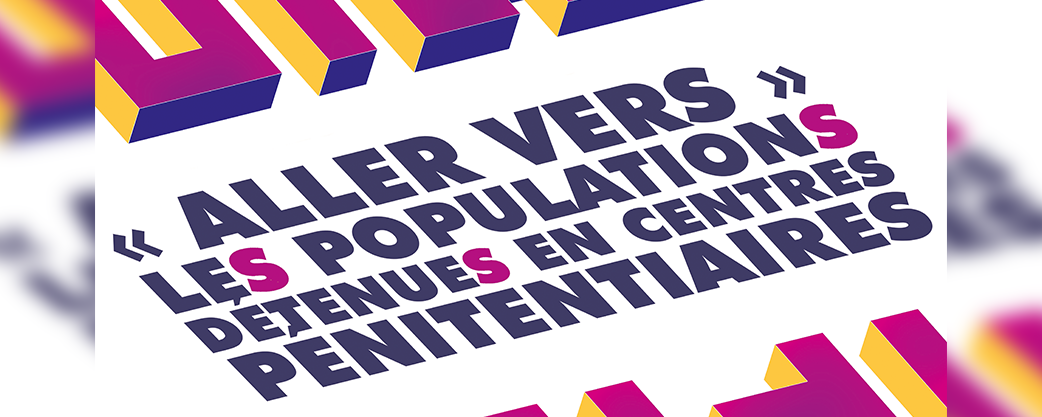Ce premier colloque « Santé sexuelle en prison » à Trans-en Provence, co-organisé par le COREVIH Paca-Ouest Corse, sous l’impulsion de Marine Guiltat, et le CODEPS 83, a permis de présenter différentes approches tout au long d’une journée riche en échanges et rencontres.
La sexualité – une réalité tacite et taboue : des approches sociologiques et juridiques
Arnaud Gaillard, sociologue, est venu partager des points clefs de ses différents travaux de recherches, effectués auprès des personnes qui encourent de longues peines d’incarcération et plus particulièrement des hommes :
Ainsi, la sexualité s’organise de manière tacite, face à un mécanisme de rupture, dans le fait de « passer du dehors au-dedans ». Au-delà des dimensions physiologiques, psychologiques, mais aussi sociales qui sont abordées avec la sphère de la prison, celle-ci recoupe également des dimensions politiques et juridiques. En effet, parler sexualité en prison, « c’est aussi parler désir, plaisir, estime de soi dans un vécu d’injustice et de colère face à la société et aux institutions ». C’est aussi un espace d’exutoire bridé, cadenassé de règles sociales et normées : Arnaud Gaillard démontre que la définition de ce que « doit être un homme » dans la société serait exacerbée en prison, notamment dans des rapports homosexuels où l’homme reste le pénétrant, et est considéré comme « sous-homme » le pénétré, au travers d’une homophobie dominante et intégrée. C’est aussi dans celle-ci que les frontières floutées entre viols et prostitution se caractérisent, dans le stigmate du « sous-homme à protéger » (en devenant l’objet sexuel d’un autre, qui sera protégé du reste du groupe). Au travers de ses différentes observations, Arnaud Gaillard a construit une typologie des besoins sexuels.
- « besoin vital non substituable » : la sexualité est un besoin vital et rien ne peut le compenser et doit avoir lieu.
- « besoin circonstancié substituable » : au gré des évènements de la vie, les personnes s’adaptent temporairement et la sexualité fluctue en fonction.
- « besoin sexuel modéré » : la sexualité peut être compensée (sport, activités…) voire annulée.
C’est dans ces différents vécus et contextes que se traduisent différentes pratiques de sexualité. Tout d’abord, une « sexualité solitaire » avec une utilisation, par exemple de pornographie, impactant la libido et le rapport à l’autre, au fantasme. Celle-ci peut être vécue comme une « régression » (comme un retour à l’adolescence, une réduction de la sexualité). De plus, il y a des pratiques homosexuelles définies à savoir « l’homosexualité de substitution » (le corps de l’autre n’est qu’un substitutif pour pratiquer la sexualité) et « l’homosexualité de circonstance » (qui ne remet pas en question les identités de genre, et plus particulièrement dans les pratiques entre femmes). En parallèle, il y a aussi la « sexualité conjugale », exprimée dans les parloirs qui se traduit dans des négociations et des arrangements, avec des surveillants, pour certains perçus comme des travailleurs sociaux, et non pas comme des acteurs disciplinaires.
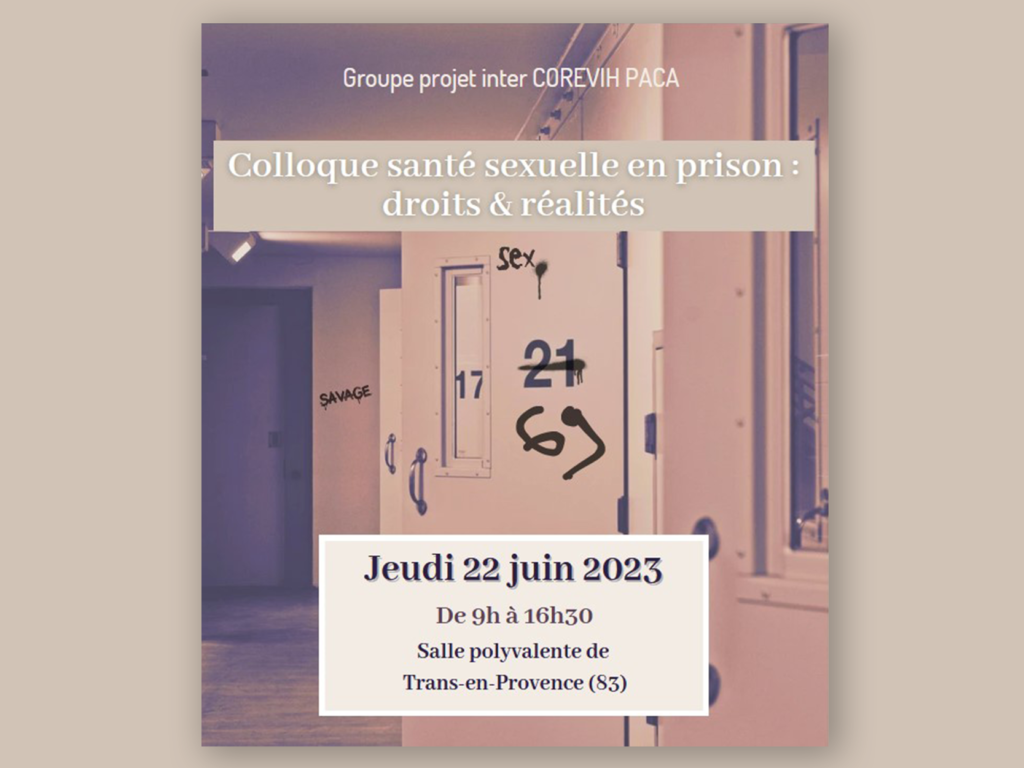
De manière générale, il faut maintenir un « drapeau de virilité » en prison, dans un contexte d’homophobie dominante : cela s’illustre avec le fait de prendre un préservatif avec soi « car c’est prendre le risque de révéler qu’il y aura rapport sexuel », et donc jugement environnant (codétenus…). Ainsi, les choses se négocient et ne se disent pas.
Ces différentes perspectives ont été complétées par Audrey Higelin, sociologue, qui a inscrit ses travaux de recherche en se demandant « dans quelle mesure la prison permet de répondre aux critères de la définition de la santé sexuelle », énoncé par l’OMS avec l’image d’une sexualité perçue comme un « objet non identifié » (Marcel Mauss), et plus précisément la sexualité conjugale des couples hétérosexuels. Elle a mis en exergue les manières de vivre les rapports affectifs notamment épistolaires, téléphoniques, fantasmatiques etc. Ainsi, différentes types de rapports ont pu être mis en lumière à savoir la relation conjugale pré-carcérale, la relation amicale pré-carcérale évolutive, et la relation conjugale née en cours de détention.
En conceptualisant différentes formes de conjugalités, Audrey Higelin a pu mettre en évidence différents vécus : l’entretien d’échanges sexuels en virtuels, « l’injonction au désir sexuel » (gérer le fait de ne pas avoir envie lors du RDV en Unité de Vie Familiale…), la culpabilité de certaines femmes de continuer de « vivre » alors que leur conjoint est incarcéré, le stigmate de la « femme » et la sanction sociale qui peut en découler (catégorie de la « salope », et pour beaucoup de femmes, d’être vigilante dans ce qu’elles dégagent d’elles-mêmes, dans leurs manières de s’habiller et se présenter pour venir voir leur conjoint en prison…).
Le temps limité de la rencontre, les conditions matérielles et les négociations avec les surveillants sont autant de critères contraignants qu’ils rendent les rencontres « insatisfaisantes », « à l’arrachée », « dans le but de s’imbriquer ».
Ces différents paramètres induiraient l’existence d’une « police du sexe », caractérisée par le jugement du comportement de l’homme en prison, privé de parloir, et donc privant aussi sa femme de le voir. Ce rapport de pouvoir de l’institution face à la sphère conjugale peut aussi se caractériser par une « police de l’intime », matérialisée par les multiples procédures administratives et de vérification afin d’accéder à un UVF (demande de réservation, conditions d’attribution, entretiens pour vérifier le lien affectif des deux personnes …) : « le fantasme de la sortie comme projection d’une meilleur sexualité peut faire tenir des couples ».
Audrey Higelin a aussi étudié les impacts de l’incarcération sur la vie de certaines femmes, à savoir les contraintes matérielles (s’organiser pour aller voir son conjoint le plus régulièrement possible), des contraintes financières (payer les billets de train, dégager des temps de congés voire se mettre à mi-temps, avec pour certaines la perte de leurs emplois…), mais aussi des conséquences sur leur santé (beaucoup de femmes ne prennent plus le temps d’aller voir leurs médecins, gynécologues voire suivis de grossesse…).
Ces différentes strates procédurales ont été agrémentées avec l’intervention de Caroline Kazanchi, avocate pénaliste, qui nous a exposé, dans un premier temps, que « la sexualité est une notion définie négativement par le droit et qu’il ne s’en saisit pas (…) le droit à la santé existe mais pas celui qui concerne la sexualité ». De fait, ce sont d’autres notions qui viennent quadriller ce sujet à savoir « la pudeur » (ex : se masturber), ou la possibilité de sanction si la sexualité est « imposée à la vue d’autrui ».
De fait, même si la sexualité n’a pas d’interdiction réelle, les conditions de détention engendrent une « interdiction de fait ».
De fait, la question de la sexualité viendrait questionner le sujet de la détention au sens large et l’effectivité des droits des détenu.e.s (octroyer des droits, et si oui, lesquels ?) face à l’opinion publique (inscrite dans un historique qui définit la prison comme punitive et rédemptrice, mais qui doit avant tout « priver de liberté »)
Durant l’après-midi, deux tables rondes ont pu être proposées, réunissant, dans un premier temps des témoignages vidéo de personnes détenues:
«Le manque de sexualité au long terme participe à la destruction de l’être ».
Des équipes de professionnel.les en centre pénitentiaire ont apporté également leurs points de vue notamment de femmes intervenantes dans des prisons d’hommes : certaines ont pu évoquer le fait de ne pas « trop se féminiser pour ne pas « susciter », ou bien « ne pas venir au naturel », leur statut de femme pouvant avoir un impact sur leurs postures ; en parallèle d’autres collègues ont présenté le soin comme favorisant le mieux-être, dans une posture professionnelle : « les personnes détenues ont une plus forte capacité à comprendre le langage non verbal ».
Des actions probantes de terrain :
La seconde table ronde a mis en lumière des actions probantes expérimentées dans différents centres de la région PACA-Corse et le partage de constats communs à leurs réussites :
- Les personnes détenues (mineures et majeures) peuvent, pour beaucoup, avoir une faible estime d’elles-mêmes.
- Parler santé sexuelle avec les personnes incarcérées, c’est avant tout partir de leurs expériences, de leurs vécus : les sessions en petits groupes comme l’offre de dépistage avec TROD sont des espaces privilégiés qui proposent des échanges intéressants sur les parcours (violences sexuelles, inceste…). Ils ouvrent aussi d’autres perspectives de sujets (ex : précarité menstruelle, anxiété et plaisir…)
- Nécessité, pour les intervenant.e.s, d’être lucides sur leurs propres représentations et être en capacité de les mettre à plat lors de ces actions : laisser l’expertise aux personnes détenues.
- L’aspect ludique et la diversité de supports permettent d’apporter une autre dynamique afin d’évoquer des sujets intimes, qui peuvent rendre mal-à-l’aise, de prime abord : nécessité d’instaurer un cadre de confiance, respect, non jugement
Arnaud Gaillard a conclu cette journée riche en échanges en évoquant les femmes, comme étant « les grandes oubliées » des prisons.
Néanmoins, il apparait clairement que le biais sanitaire permet de faire avancer les choses, comme porte d’entrée d’initiatives dans les institutions carcérales.